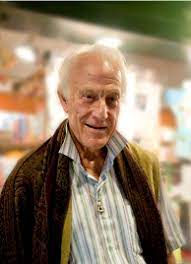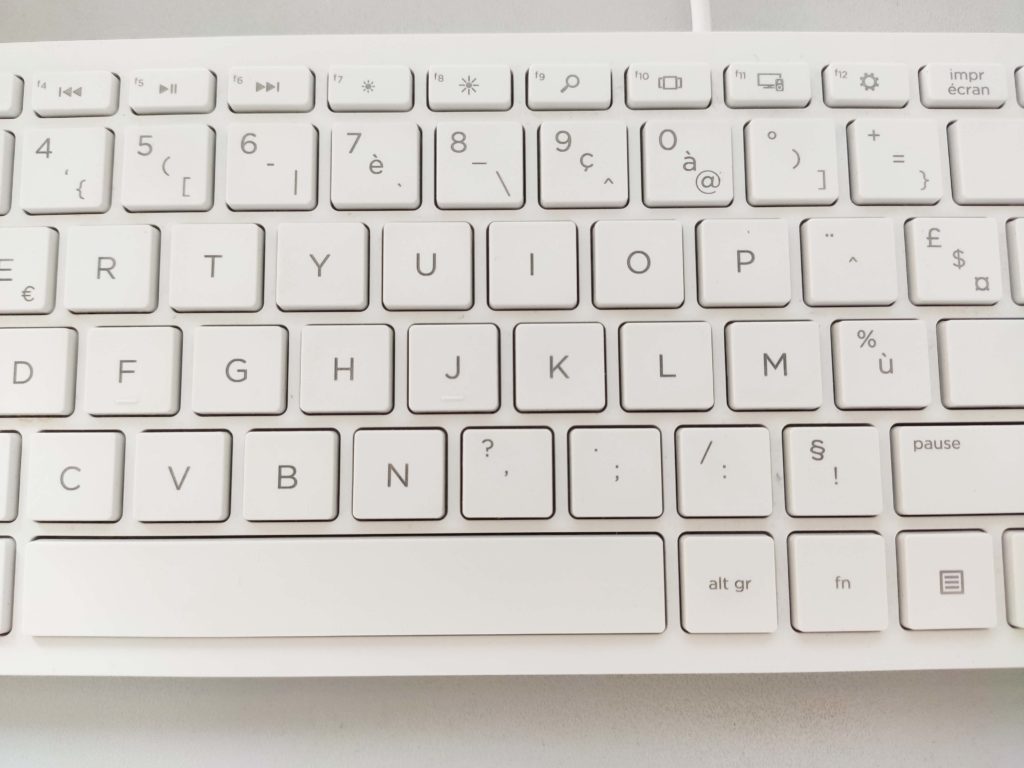Nicky a connu Gilles en classe préparatoire des concours scientifiques. Ils avaient dix-huit ans et déjà Nicky montrait un penchant pour la gastronomie, économisant pour aller dîner au Chapeau gris à Versailles. Il est vrai qu’il avait de qui tenir, son père étant « nez », expert en parfumerie. Par la suite, il entra à l’INSEE, institut national des statistiques, où il rencontra son épouse Noëlle. Ils y firent de belles carrières, mais leur principal intérêt tourna autour de la cuisine. C’est avec la cuisine qu’ils s’exprimaient, invitait leurs amis, ce fut leur façon de converser avec le monde, pour ne pas dire leur façon d’aimer.
Je me souviens que nous roulions le long d’un petit bois près de Saint-Jean de Luz lorsque sans un mot, Nicky a freiné brutalement pour se ranger sur le bord de la route. Noëlle est sortie de la voiture comme un diable de sa boite pour aller cueillir des fleurs d’acacia, avec lesquelles, le soir même, elle nous confectionna de délicieux beignets. À sa mort, nous avons beaucoup craint pour Nicky. Quelques mois plus tard, nous avons reçu une invitation par mail. Il s’engageait à recevoir de nouveau à dîner. Il enverrait le menu à la liste de ses amis. Il suffisait de réserver, il nous accueillerait chaque mardi dans la limite des places disponibles. Il se substitua à Noëlle, nous demandant simplement d’assurer la conversation pendant qu’il serait à ses fourneaux.
Je me souviens d’un mémorable poulet de Bresse aux morilles. Un des plaisirs de ces dîners était la surprise de voir des gens que nous n’aurions pas rencontrés autrement. Puis le Covid a tout arrêté, jusqu’à la semaine passée où nous nous sommes retrouvés à dix retraités autour de sa table : des voisins, un cousin très âgé, un général à cinq étoiles, une ancienne responsable nationale de l’énergie…, comme les ratons laveurs de Prévert. Nous avons passé en revue les préoccupations et les joies de l’époque, en dégustant de bons vins et en savourant un poulet aux topinambours. Carpe diem !
Une civilité en contraste avec le vacarme qui a retenti sous nos fenêtres le vendredi suivant. Nous regardions tranquillement un film lorsque vers 22 heures, un bruit de tambour a littéralement arraché les doubles vitrages de nos fenêtres sur la rue. Les « artistes en exil » ? Ils ne nous posent plus de problèmes depuis les interventions du mois dernier. Pour en avoir le cœur net, j’ai enfilé un manteau. Dans l’ascenseur, j’ai rencontré le psychiatre du quatrième, toujours aussi élégant, cheveux de neige :
— Je descends pour me renseigner sur ce bruit.
— C’est insupportable ! s’indigna cet homme particulièrement discret et paisible.
Aussitôt passés la porte, nous avons été sonnés. Cela provenait d’une grosse voiture utilitaire noire garée dans la pénombre devant chez nous. Elle était surmontée de deux baffles et d’un volumineux système de projecteur accrochés à une structure métallique. Trois jeunes gens tournaient autour avec des mines de conspirateurs. Je mis du temps à comprendre qu’ils projetaient une image sur le mur aveugle de l’immeuble à l’angle de la rue du Louvre. Sur une surface de trente mètres de haut et de dix mètres de large, on discernait des objets qui ressemblaient à des piles électriques. Incrédule, je restais figée, lorsque je vis mon paisible voisin se jeter sur les jeunes gens en hurlant et en gesticulant :
— Vous allez arrêter ça tout de suite !
Constatant qu’ils ne se troublaient pas le moins du monde, le médecin continua plus énervé encore :
— Je parie que vous êtes des artistes !
Et les jeunes gens arborèrent un sourire de satisfaction qui en disait long sur leur fierté d’appartenir à cette honorable corporation.
— Vous vous « croyez » des artistes ! hurla le psychiatre avant de s’éloigner.
Comme je m’approchais pour protester à mon tour, la femme qui semblait la responsable, sa commande à la main, me déclara, le visage serein, sûre de son fait :
— Si ça ne vous plaît pas, ça plaît à d’autres !
J’ai fini par comprendre qu’il s’agissait d’une publicité sauvage. Quand je suis remontée après quelques échanges bien sentis, ils avaient baissé la sono.