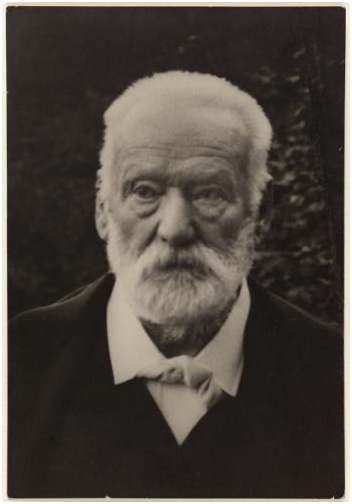Feu rouge, rues désertes, patinettes entassées. A l’image de cette photo Paris est à l’arrêt. Dimanche, j’ai voulu me dégourdir les jambes, mais le jardin du Palais-Royal était fermé. Des jeunes, inconscients, agglutinés, assis au soleil sous les arcades m’ont aussitôt fait fuir. J’ai repris ma déambulation en slalomant pour garder la distance recommandée par le monde médical.
Le Coronavirus, Cov 19, est en train d’exploser. La semaine dernière, après beaucoup d’hésitations nous avons encore pu écouter Sandrine Bonnaire lire les poésies de notre ami Joël Bastard au Bataclan. Nous nous étions assis au fond de la salle en retrait, sans voisins, et nous sommes partis aux premiers applaudissements. Spectacle d’inauguration (le dernier, vu les circonstances…) du Printemps des poètes, placé sous le signe du Courage. Le Bataclan !… Il semblait encore vibrer du silence terrifié des victimes des terroristes, tapies entre les rangées de fauteuils ou derrière le bar, réfugiées dans les toilettes, ensanglantées, blessées ou mortes. Je ressentais encore l’horreur planer sur cette salle remplie de cette même jeunesse vivante et curieuse, sur laquelle, le 13 novembre 2015, s’était déversée la haine dans une ivresse de mort. Une lecture de Féderico Garcia LLorca, avec la voix rauque de Denis Lavant : Las cinco de la tarde, le chant funébre du torero Ignacio Sanchez. Pas gai, mais très beau.
Mercredi, Les Méditations de Lamartine à la Sorbonne au cours de Jean-Marc Hovasse. Lecture émouvante de L’Isolement (d’actualité), du Vallon et bien sûr du Lac. La poésie, nourriture de vie.
Nous avons ensuite tout annulé : concert, dîners, réunions, avant même les déclarations de jeudi du président de la République. Nous mettons maintenant en place les conditions de ce confinement qui risque, si l’on en croit les nouvelles de Chine, d’être beaucoup plus long que la quinzaine (renouvelable) évoquée par Emmanuel Macron. Pour le moment chacun se replie sur ses problèmes. Beaucoup de familles parisiennes partent dans leurs maisons de vacances, à la campagne ou dans les îles bretonnes. Nous, nous préférons rester à Paris où la couverture sanitaire est plus efficace. Nous nous trouvons largement dans la tranche vulnérable.
Nous avons voté pour les municipales en prenant toutes les précautions nécessaires. Les mêmes politiques qui jugeaient ces élections indispensables sont aujourd’hui ceux qui les condamnent à grands cris médiatiques. Il est pourtant plus qu’urgent de passer à autre chose ! Le deuxième tour est reporté sine die.
Nous pratiquions déjà depuis une dizaine de jours les préconisations désormais obligatoires, mais comment savoir si un virus, cet ennemi minuscule et invisible n’a pas traîtreusement franchi la barrière de nos narines et ne s’est pas installé, peinard, dans nos bronchioles ? Mieux vaut prendre toutes les précautions et ne pas trop y penser. Nous sommes tous dans le même panier et si pour le moment nous n’utilisons pas encore les moyens de communication au-delà de nos familles proches, nous n’en songeons pas moins à tous les autres, les amis, les voisins, le personnel soignant, ceux qui travaillent pour assurer notre quotidien de confinés, avec un sentiment de solidarité omniprésent dans cette nouvelle solitude peut-être riche d’enseignement. Qui vivra verra… (!)