
Rue Cassini, Pigalle.

Deux concerts. Le premier rue Cassini, près de l’Observatoire. Ce fut une surprise de découvrir des façades Art Nouveau en continu le long du trottoir. Au 5, au bas de la façade de briques rouges, la porte arrondie était ouverte. Je fus accueillie par un homme qui prit mon manteau avec une rare courtoisie. Comme je lui faisais part de ma surprise et de mon admiration, il me répondit :
— C’est mon arrière-grand-père qui a fait construire cette maison. Le peintre Jean-Paul Laurens. Vous ne connaissez probablement pas.
Comme je hochais la tête, ce nom me disait quelque chose.
— Un peintre d’histoire.
(En fait, l’auteur de fresques au Panthéon, à la bibliothèque de la Sorbonne)
Il ajouta :
— Nous avons eu la chance de pouvoir la garder dans la famille et nous organisons des événements dans l’atelier.
Il me montra un large escalier à balustres en chêne sculpté.
— Montez, c’est tout en haut !
J’entrais dans l’atelier du peintre, très haut de plafond, une quarantaine de chaises y tenaient à l’aise. Une large mezzanine courait sur deux côtés, sous laquelle des divans recouverts d’indiennes étaient disposés en espaces plus intimes. Un piano demi-queue trônait au pied d’un vaste mur entièrement recouvert de toiles du début du vingtième siècle : des paysages, des portraits aux couleurs un peu noircies dans leurs cadres dorés. Des photos de famille sur une commode. Parsemés sur les meubles le long des murs des bibelots, des petites sculptures.
J’ai retrouvé quelques visages connus dont le grand pianiste Éric Heidsieck et son épouse Tania. J’ai embrassé Muse leur petite-fille avec laquelle j’ai fait du théâtre et je me suis assise sur un divan sous la grande verrière occupant tout le mur sur rue. Nous étions réunis autour de Quing Li pour le rodage du concert qu’il devait donner le dimanche suivant à la salle Cortot.
Il commença par une sonate de Beethoven qui me déçut un peu, trop chaotique pour mon goût. J’avais tellement aimé le concert de Philomuses, d’il y a un an ou deux ! Et j’avais froid. Un courant d’air me tombait sur la nuque depuis la verrière, je risquais un torticolis. J’ai profité d’une pause pour changer de place. Assise derrière, à côté de l’escalier de pitchpin qui montait à la mezzanine, j’étais libre de me lever, de bouger sans gêner personne et quand Quing Li démarra des pièces de Debussy, ce fut une merveille. Je crois n’avoir jamais entendu plus coloré, plus délicat, plus vivant. Un monde de sensations nous enveloppaient par la grâce d’une virtuosité qui ne s’imposait jamais. Un moment de liberté.
À la fin et après avoir rangé les chaises, nous avons pu discuter avec le pianiste, inquiet de nos impressions et surtout, bien sûr, de celles des Heidseick. Ils furent unanimes pour Debussy :
— C’était superbe. Rien à redire ! dit Tania
Éric lui dit en riant :
— Pas de poussières !
Il raconta que sa mère, musicienne, lui disait cette phrase quand il avait bien joué. Il fallait dépoussiérer la musique.
Avant de partir, je dis à Tania :
— Croyez-vous qu’on puisse avoir une opinion quand on n’y connait rien ?
La réponse fusa, large, inattaquable :
— Vous êtes le public !
Honneur qui me rendit un peu confuse. Le talent, l’immense travail des créateurs et des interprètes m’ont souvent paru disproportionnés avec l’écoute d’un public peu averti tranquillement installé dans son fauteuil.
J’eus la même impression le lendemain soir, à la Boule noire, café-concert de Pigalle, en écoutant Sarah Olivier. Concert rock, électro, lumières lasers, décibels.
Extravagante, valse de cheveux blonds, manches gigot à paillettes, lèvres écarlates, elle se déchaînait sur la scène au milieu de ses musiciens, micro fixe ou dans la main. En cris et murmures, elle offrait à son public sa vitalité, comme une déclaration d’amour. Ses chansons dont on ne comprenait pas toujours les paroles, exprimaient ses désirs, ses révoltes. Elle les partageait avec la centaine de personnes debout dans l’obscurité, un verre à la main. Et les pieds tambourinaient, les têtes se secouaient, les corps accompagnaient les rythmes rockies. Clameurs à la fin de chaque chanson. Du délire après l’une d’elles, un peu plus wave.
Debout devant deux larges consoles, attentifs, les yeux fixés sur Sarah, deux hommes d’une quarantaine d’années, manipulaient les leviers, impassibles. Ils assistaient le son des guitares électriques, de la contrebasse, du micro, avec tendresse, presque religieusement. Nouveau piano, nouvel instrument, ils faisaient corps avec la chanteuse.
Quand je suis sortie sur le boulevard Rochechouart désert, on sentait à la toucher, la nuit parisienne. On devinait derrière chaque porte un spectacle, des lumières, tout un monde noctambule. Il y avait là quelque chose d’émouvant.
Pauline, Xiaoli et Cie

Tout redémarre. Les ouvriers travaillent de nouveau sur la toiture, Maria, notre gardienne est revenue de ses vacances en Espagne, l’immeuble a retrouvé ses occupants partis fêter Noël et le jour de l’An en province ou à la campagne. Dimanche, les gilets jaunes ont repris leurs manifestations.
On s’attendait à des foules. Le souvenir du vandalisme de l’Arc de triomphe, des vitrines cassées, des pillages reste vivace. Quelques centaines de manifestants se sont éparpillés dans la ville, encadrés par des milliers de policiers. La préfecture a-t-elle trouvé le moyen de neutraliser les casseurs ? Très peu de voitures brûlées. Les touristes reviennent, surtout les Européens.
Dans notre quartier, les touristes sont nombreux, on frémit à la pensée de la foule des Chinois déconfinés et bientôt autorisés à quitter leur pays. Difficile de se souvenir du centre de Paris déserté, sans aucune trace humaine au début de l’année 2020. Difficile de se souvenir des craintes à la moindre sortie, des métros vides.
Aujourd’hui, Parisiens, banlieusards et visiteurs, tout le monde se bouscule dans les transports en commun, la RATP manque de conducteurs. Depuis les confinements, le retour au travail se fait avec difficulté dans beaucoup de branches. Les restaurants, la poste, la santé, les chantiers peinent à trouver des travailleurs. Où sont-ils passés ? Nul ne le sait. Le chômage n’est plus d’actualité.
On doit encore se forcer pour sortir de la léthargie qui a entouré la pandémie de Covid 19. Samedi et dimanche, nous avons reçu des cousins et des amis. Nous avons tous dû nous secouer un peu. Nous avons perdu l’habitude des conversations. Silence ou monologues se succèdent, il faut se forcer un peu pour dialoguer. On s’y remet avec bonne volonté.
Dimanche, pour la fête des rois, c’était encore plus compliqué (on ne dit plus facile ou difficile). Nous avions invité Tim, Américain avec son épouse, Xiaoli, une Chinoise récemment naturalisée française, ainsi que Susie. De retour de San Francisco, Barbara, notre amie américaine qui retournait chez elle à Ferrare en Italie, s’était jointe à nous. Tous polyglottes. La langue commune aurait dû être l’anglais, mais je ne le parle pas. À l’école j’étais nulle et je ne suis jamais parvenue à me l’entrer dans le crâne.
Heureusement, la belle Susie, professeure de français à Melun, a gardé le cap avec sa voix chaude et calme, son articulation précise, sa musicalité. J’ai remarqué une fois de plus combien les mots dans une langue étrangère n’ont pas la même implication que dans une langue maternelle. En compagnie internationale, on survole afin de balayer large et on ne sait pas bien ce qui est compris. Il s’ensuit un flottement, plus ou moins perceptible. On le comble par des mimiques, comme des émojis. On se fie à l’amitié.
Samedi, Pauline avait accompagné ses parents. Née handicapée par une maladie rare, à cinquante ans elle garde une mentalité d’enfant et vit dans un foyer adapté. Elle possède une fraîcheur de réaction qui fait plaisir. Elle exulte de joie quand elle est contente. Elle écoute et on se demande ce qui lui passe par la tête. Comme nous évoquions le Par Cœur du Palais-Royal, elle a récité plusieurs vers du Corbeau et du Renard, soutenue par la tablée. Elle y a mis une charmante bonne volonté. Claudine, sa mère nous a raconté qu’elle-même se récitait des poèmes quand elle ne parvenait pas à s’endormir, dont le Dormeur du Val, de circonstance.
Pauline s’est arrêtée devant mon tableau du salon et le pastel de marguerites blanches sur le chevalet avec un sourire heureux. « J’aime bien ça ! » a-t-elle dit quand on ne s’y attendait pas. Et son regard sans préjugé, primitif en quelque sorte, m’a fait plaisir.
Fin d’année.

Encore une année ! Quatre-vingt-trois, ça fait beaucoup ! Comme dit celui qui tombe du haut du gratte-ciel : « Pour le moment ça va ! ».
Les enfants partis, une semaine remplie nous attendait. Elle avait pourtant bien commencé.
Nous avions retrouvé Julien, Laure et Thomas, à la fondation LVMH du bois de Boulogne pour voir l’exposition Monet-Joan Mitchell. Curieuse confrontation entre le pape de l’impressionnisme et la Franco-New-Yorkaise dont j’avais remarqué le foisonnement et la force dès ses premières expositions. Quelle énergie ! Tous deux proches de la nature, tous deux immergés dans la lumière de la vallée de la Seine. L’un sensuel et visuel, l’autre physique et abstraite. En sortant, Thomas a dit : « Je préfère Monet ! » et je crois que cela m’a fait plaisir.
J’ai particulièrement été impressionnée par l’architecture de Franck Géry. Dans la lumière du soleil d’hiver, bas sur l’horizon, je me suis sentie enveloppée, comme dans des ailes de papillons. Les voiles de verre semblaient soulevées et gonflées par le vent du soir. Par l’espérance ?
Avec les mêmes, nous sommes ensuite allés à la Comédie française voir La Puce à l’oreille (notre cadeau de Noël !). Placés comme des rois au premier rang du premier balcon, nous n’avons pas perdu une miette du remue-ménage de Feydeau réglé comme une horloge. On a ri de ses quiproquos, des hurlements, des cascades, des ridicules, des outrances, de ses invraisemblances. Les comédiens pulvérisaient la léthargie qui continue de miner les théâtres après deux années d’épidémie. La metteure en scène suisse, Lili Baur, avait situé son spectacle dans une station de sports d’hiver des années 60. Derrière une grande verrière, on voyait de temps en temps passer des skieurs de fond, levant haut les genoux et se démenant dans la neige et on riait à chaque fois. Les grands moyens de la Comédie française au service de Feydeau. De quoi vous regonfler.
On avait prévu de recevoir les cousines Callies et leur famille, puis Tim et Xiaoli. On avait hésité à faire signe à JMH et sa famille, ne sachant pas s’ils étaient partis et revenus de Strasbourg comme ils en avaient le projet. Et voilà que jeudi, je me suis retrouvée au lit avec une névralgie dans le dos.
Il a fallu tout annuler. Trois jours à se tortiller, à se bourrer de Doliprane, de calmants, à ne dormir que quelques heures. Triste 31 décembre, heureusement un peu égayé par la fête et les rires de nos voisins. Je me serais tout de même passée des improvisations des jeunes sur un piano électrique récemment installé. Espérons qu’ils feront quelques progrès ou qu’ils mettront un casque…
Merci à tous ceux qui m’ont réchauffé le cœur avec leurs messages dans la nuit.
Maintenant, je m’étonne de ne plus souffrir, j’ai même oublié. L’année commence sur les chapeaux de roue. On a tout repoussé d’une semaine, je suis retournée à l’atelier, je vais démarrer un four.
Merci à tous ceux qui ont accompagné nos pas durant cette dernière année et vive l’année nouvelle ! Qu’elle nous apporte à tous, santé, aventures, amour et amitié ! Que la paix gagne dans le monde. Je vous embrasse.
Noël en famille
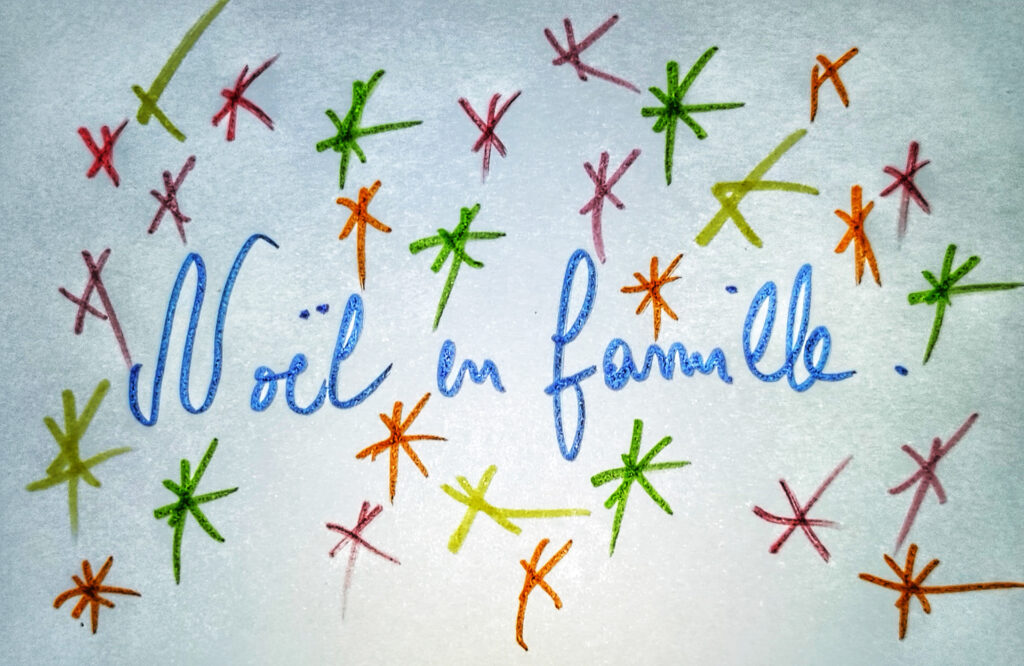
Les Noëls se suivent et ne se ressemblent pas.
Dans les faits, oui. Les retrouvailles, l’installation des lits, les activités des uns et des autres, les achats de dernière minute, les menus, les courses se déroulent tous les ans avec la même vitalité, presque à l’identique. Nous nous retrouvons tous ensemble la veille de Noël et le lendemain, enfants et petits-enfants se dispersent dans les belles familles, à Paris pour les uns, vers Rouen pour les autres.
En réalité, des nuances se font sentir. Le passage du temps marque l’année écoulée. Chez nos enfants, des cheveux blancs apparaissent, l’expérience teinte les propos, chez nos petits enfants, les aînés sont désormais des adultes, étudiants, mais adultes, les deux autres évoluent dans l’adolescence, rude période de changements.
Et il faut suivre, ce n’est pas toujours facile. S’adapter ? Impossible. Les habitudes ont évolué. Nous nous contentons d’être attentifs, de les observer avec autant d’humour que possible, veiller à ne pas juger trop vite des comportements souvent transitoires. Des perles peuvent surgir d’une liberté d’expression dont nous n’avions pas l’usage à notre époque. De même que nous avons oublié les nuits agitées de la petite enfance, nous ne nous souvenons plus de l’adolescence de nos enfants. La prudence s’impose. Les conversations deviennent plus intéressantes, les sujets plus variés, les attitudes séduisantes.
Quel plaisir d’entendre une réflexion inattendue, une proposition pleine d’imprévu ! Des blagues fusent. Fête par nature affective, il nous est aussi arrivé, comme dans toutes les familles, de lever la voix. Noël est aussi fait pour ça. Cette année, ce fut très paisible.
Pendant trois jours, les Grenoblois se sont promenés dans Paris, ils ont revu des amis du temps de la faculté, vu un spectacle près de la République (ils ont traversé la manifestation qui a suivi l’attentat dans le centre culturel kurde), ont visité la BNF restaurée… et n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.
Le soir, ce fut un dîner affectueux, tranquille et joyeux. Distribution des cadeaux. Touchée par celui de Thomas, un joli savon parfumé qu’il avait acheté tout exprès cet été pendant sa colonie de vacances au bord du lac de Serre-Ponçon.
Le lendemain matin, épuisés, nous ne les avons pas entendus défaire les lits, remplir leurs valises, prendre leur petit déjeuner. Ils nous ont réveillés juste cinq minutes avant de partir. Nous les avons vus disparaître dans l’escalier avec un rien de nostalgie.
On se reverra à Pâques !
Enfin nous nous sommes retrouvés seuls, dans le silence, dans un immeuble déserté. Et on a dormi, dormi…
C’est seulement maintenant que je retrouve mon train-train, grâce à vous, amis lecteurs.
A la réflexion, une question me tourne dans la tête. Leur univers, notre univers tourne désormais autour des mobiles. Nous sommes constamment reliés au monde par internet. Nous y passons des heures. Dans le métro, comme chez nous tous, les nez sont plongés sur ce petit quadrilatère de seize centimètres sur sept.
Le spectacle du salon et des mobiles se substituant à la parole me tarabuste. Contente de trouver des réponses à mes questions (obligée tout de même de recouper les informations), de suivre l’actualité en continu (avec les mêmes précautions…), je suis heureuse de pouvoir joindre mes amis grâce aux messageries, mais j’y suis mal à l’aise. Il me manque les mimiques, les odeurs, la chair, les sourires, mais surtout le mystère et le temps. Je rêve parfois la nuit que je me bats avec les touches de mon smartphone et que je suis larguée, mes doigts sont trop gros, les touches trop serrées, la charge insuffisante. Je ne peux pas regagner le groupe que ma rêverie et mon insouciance m’ont fait perdre au fil de la marche. Je ne trouve pas les numéros de téléphone.
Impossible de savoir s’il s’agit de maladresse ou d’une réaction à un monde se virtualisant à l’excès, ou les deux à la fois…
Coupe du monde de foot.

Comme il est difficile de savoir ce que l’avenir retiendra de ces observations notées sur le moment ! L’écriture dépend de l’humeur de son auteur, de ces états d’âme, mais la lecture est encore plus subjective. Quand je me relis, l’auteur et le lecteur se confondent, je vous laisse imaginer se qui se passe dans ma tête !
Cher lecteur, je vous espère à mes côtés pour retenir ces miettes du temps qui passe, en toute liberté, promenade commune dans le jardin de nos vies.
Hier, finale de la coupe du monde de foot. Quelle histoire !
Organisée en plein désert dans des conditions désastreuses tant sur le plan humain qu’écologique par le Qatar, émirat pétrolier richissime, on aurait dû bouder l’événement. On aurait presque pu…
Mais on gagnait ! La France a gagné jusqu’à la finale de dimanche.
Retransmis dans le monde entier, les matchs ont peu à peu éclipsé la guerre en Ukraine, l’économie en berne, le froid, les distributions alimentaires. Ce grand jeu et ses aléas, ses espoirs, ces déceptions, la vitalité des joueurs, ses règles (pour moi incompréhensibles), son rythme, ses réussites et ses ratages, les commentaires ont cristallisé l’intérêt général. Et tout le monde a sauté de joie sur sa chaise, ou pleuré sur son canapé, dans les foyers, dans les bistros, sur les places, énorme fête de plusieurs milliards de participants.
Mais la plus émotive, la plus excitante, la plus éprouvante fut bien la finale de dimanche !
Ah ! Mbappé, héros des temps modernes. Jeune hérault de l’équipe de France, d’origine camerounaise et kabyle, il affrontait Messi, la glorieuse star de l’équipe d’Argentine, pour le dernier match de sa carrière, pour le seul trophée qui lui manquait. La jeunesse et l’expérience. Le monde balançait entre ces deux équipes.
La semaine précédente, l’équipe de France avait été éprouvée par un virus privant d’entrainement plusieurs de ses joueurs, mais on ne s’attendait pas à une première mi-temps aussi calamiteuse. L’Argentine a dominé et placé deux buts. On avait perdu espoir, quand à la reprise, après un penalty réussi, on a vu Mbappé cavaler, se jeter sur le ballon, mettre un but d’égalisation. Messi a de nouveau frappé, sa dernière gloire ! Mais Mbappé, quelques secondes avant la fin des prolongations a magistralement égalisé. 3-3 ! Tirs au but. Le souffle coupé, on a vu l’impensable se produire. Les Français qui avaient toujours eu l’avantage dans cet exercice ont raté deux buts et ont perdu ! Match, homérique, épique, mémorable, qui restera dans toutes les mémoires.
J’en retiens les regards des deux héros, une sorte de naïveté, une ouverture de tout leur être, physique et mentale, soudés à l’équipe, à l’entraineur, en même temps superbement libres et inventifs. À la fois dans le jeu et au milieu de la foule. Oui, ce sont bien des héros des temps modernes. Comment les footballeurs peuvent-ils courir plus d’une heure et demie après un ballon, le chercher, le perdre, le lancer, avec une telle intelligence et en même temps assumer le poids de ces milliers de spectateurs, de ces milliards de regards à la télévision, pour ou contre eux ? Et il faut bien l’ajouter, le poids des milliards de dollars dépensés et gagnés dans l’organisation de la compétition. Voilà qui semble surhumain.
Mbappé s’est assis sur la pelouse, inconsolable. Rien n’y fit, la présence du président de la République, de Didier Deschamps. Visage figé, il a gagné la sortie et c’est dans les bras de son père qu’il a éclaté en sanglots. Il n’a que 24 ans !… L’avenir est devant lui.
Messi et l’Argentine ont laissé éclater leur joie. Pays accablé par une crise financière, il avait fourni 50 000 supporters dans les gradins de Doha, contre seulement quelques milliers de Français. Symbole de vitalité ou besoin de symbole ? Jeux du cirque ou apprentissage du talent et de l’affrontement ? Probablement les deux à la fois.
Et qu’en est-il du Qatar, pays secret, dans tout ça ? On n’en sait trop rien.
Livilliers et l’ENS

Laissant Gilles et Yves monter à Livilliers, je suis allée avec Marc au pot de départ de Christophe Duvivier organisé par la Ville de Pontoise. Christophe a travaillé durant toute sa carrière dans les deux musées de la ville. Au démarrage chapeauté par Edda Maillet, une amie de Dina Vierny, il en a fait une référence au-delà de la commune et même du pays. Il est maintenant spécialiste-expert de Pissaro, lequel a peint de nombreuses années à Pontoise et dans ses environs. Discours qui m’a ouvert les yeux sur les dessous de la politique culturelle nationale comme locale : politique, argent, liens amoureux. Difficile après ça de situer la qualité des œuvres d’art pour elles-mêmes !
L’ancien maire et député, Philippe Houillon était présent. Il ne s’est pas représenté aux dernières élections.
— J’ai préféré m’arrêter quand on voulait encore de moi ! m’a-t-il dit avec humour.
Avocat, il a été rapporteur de la commission d’enquête de la douloureuse affaire d’Outreau. Il a participé au rétablissement de la vérité. Il a repris son métier à plein temps.
En regagnant son bureau à pied, Marc m’a fait les honneurs de sa ville. Comme elle a changé depuis mon enfance ! Pendant la guerre, de nombreuses maisons ayant été bombardées nous montions à l’école en passant par-dessus les gravats, entre des façades noires et lépreuses. Aujourd’hui, charmante ville historique autour de sa cathédrale, places mises en valeur, façades restaurées, c’est un lieu de rencontre. Un grand parking au-dessous du jardin de la ville a permis le retour des commerces et des restaurants. Marc, conseiller municipal à la culture durant des décennies, a participé à cette réhabilitation. Une histoire d’amour entre lui et sa ville.
Nous avons retrouvé à Livilliers les trois autres qui nous attendaient autour d’un verre de champagne. Catherine avait préparé un repas succulent. Quel plaisir ce fut de nous retrouver dans la cuisine pour cause de chaleur, entre frères, sœur, beau-frère, belle-sœur ! Des histoires de famille ont fusé sans vergogne, des histoires de métiers, des souvenirs, des évocations, des anecdotes amusantes, parfois de la gravité évoquée avec le respect dû aux aléas de la vie. À nos âges, on a intérêt à en profiter.
Au dernier moment, Hervé et Véronique n’avaient pas pu se joindre à nous pour cause de Covid. Au dessert et au téléphone, nous avons fixé un autre rendez-vous pour la mi-janvier.
— La répétition générale est réussie. On ne changera rien, a dit Marc.
— Je ferai le même poulet au citron, a dit Catherine.
— On apportera le même champagne, ont dit Yves et Gilles.
Café et retour sur Paris en train pour Yves, Gilles et moi. Vite fait, bien fait. Il faut dire que pour le moment et espérons encore pour aussi longtemps que possible, nous sommes tous très occupés.
Samedi, à l’ENS, Séminaire sur les correspondances. Une fois de plus, j’ai été admirative de la rigueur et la passion qui président à ces communications suivies de publication. Il s’agissait de la correspondance de Beaumarchais, plusieurs milliers de lettres. À cette époque et jusqu’au milieu du vingtième siècle (l’arrivée de la voiture et du téléphone ?), écrire des lettres était un art. Grâce à l’Item, je m’émerveille de voir surgir derrière l’écrivain, un personnage plus intime, plus familier, dont les préoccupations, les sentiments éclairent l’œuvre.
Dans mon enfance, alors que nous passions les vacances à Nernier sur les bords du Léman, mon père restait travailler durant le mois de juillet à Pontoise. Ma mère lui écrivait tous les jours. Marc a pieusement conservé cette touchante correspondance. On y retrouve les faits et gestes des uns comme des autres, les incidents, les bonnes nouvelles, les demandes, les marques d’affection. C’est peut-être ce souvenir qui me motive, alors que je dois me pousser à chaque fois, tant l’ENS est mal desservie par les transports en commun.
Julien et son fils Thomas au débotté après une visite à la BNF recommandée par une professeure.
Froid. On jongle avec les radiateurs sur recommandation du gouvernement. Comment ne pas penser aux Ukrainiens dont les fournitures d’énergie sont systématiquement détruites par la Russie de Poutine ?
Lectures

Gilles avait suivi quelques récitants du Palais-Royal à la librairie Delamain. Ils s’y retrouvaient entre Amis de Marcel Proust autour d’un verre à l’occasion du centième anniversaire de sa mort. Il en était revenu avec un petit livre d’extraits de La Recherche du temps perdu, réunis et commentés par Philippe Delerm, l’auteur hédoniste d’Une petite gorgée de bière.
J’ai mis un certain temps avant de m’y plonger. J’avais lu ce gigantesque ouvrage à l’âge de vingt-cinq ans, grâce à mon frère Hervé. C’était le sujet de son cours de français en préparation scientifique à Stanislas et nous avions échangé nos impressions avec délectation, tome après tome. Depuis, j’ai craint d’en ternir le souvenir par des relectures trop répertoriées. Le Musée du Louvre, La Recherche du temps perdu, sont associés pour moi à des déambulations dans des jardins. Je vais et viens en toute liberté dans des floraisons ressemblant à la vie, l’authentifiant en quelque sorte. Grandioses comme Les Noces de Cana, comme les phrases de Proust s’étirant sur deux pages ou plus modestes mais tout aussi fortes, comme La Dentelière de Vermeer ou les levers du jour à Combray. J’en aime les rythmes, les saisons, les couleurs et les sensations et je communie avec leurs auteurs comme avec des amis.
Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues…
Finalement, je me suis régalée des extraits choisis par Philippe Delerm.
Récemment, j’ai essayé de la relire, mais je n’en suis plus capable. J’ai oublié le début de la phrase quand j’arrive à la fin. Je ne peux plus me fixer sur une histoire compliquée, alors que j’ai du mal déjà à retenir le temps qui file de plus en plus vite.
Merci à Philippe Delerm pour ce petit livre qui m’a permis de rouvrir des fenêtres que je croyais fermées à jamais. Avec le temps, j’ai davantage apprécié l’évocation de la petite madeleine, elle a fait remonter en moi des plaisirs oubliés. J’ai aimé son humour corrosif, le sourire de la grande duchesse destiné à la grand-mère de Proust comme on lance des cacahouètes aux animaux dans les zoos, ou du pain aux canards, la mort de l’écrivain Bergotte confronté à son œuvre devant un tableau de Vermeer. Tous ces personnages m’avaient été si familiers !
Peut-être, aujourd’hui, y ai-je noté moins l’empathie de l’auteur qu’une hypersensibilité aux blessures, aux souffrances infligées tout au long de sa vie. Pas rancunier, grâce au souvenir, il a offert une impérissable existence à ses modèles, n’est-ce pas le plus beau des cadeaux à leur faire, à nous faire ?
Pierre Christin, secoué par l’exposition de Gérard Garouste, nous avait conseillé d’acheter son livre : L’Intranquille.
Un témoignage courageux ! Le peintre dont nous avions vu l’exposition-rétrospective la semaine dernière à Pompidou a souffert de troubles psychiatriques importants durant la plus grande partie de sa vie. Diagnostiqué maniaco-dépressif, il fut hospitalisé à de nombreuses reprises, représentant un danger pour lui-même comme pour son entourage. Il y analyse ses crises avec une vérité, une précision qu’on ne trouve pas dans les documentaires sur le sujet. Dans son Autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou, Gérard Garouste refuse d’associer cette souffrance à l’œuvre d’art.
On ne peut peindre que si l’on va bien… Le délire ne déclenche pas la peinture et l’inverse n’est pas plus vrai. La création demande de la force… Pourquoi un artiste n’aurait-il pas le droit, lui aussi à l’équilibre ?
Il raconte une enfance massacrée par la violence verbale d’un père psychopathe et antisémite. Converti au judaïsme par réaction, il a trouvé dans le Talmud une liberté qu’il ne trouvait pas dans les autres grands textes religieux.
Il évoque souvent son refus du beau, de la beauté. Faites laid ! lui a dit son psychiatre. Et là, je ne comprends pas. Pour ma part, je ne sais pas ce qu’est la beauté. La plupart du temps, je m’étonne de ce qu’on trouve beau. Cela dépend tellement de la mode, des habitudes, des a priori, de l’humeur et même du temps qu’il fait. Pour moi, la beauté n’est pas vraiment un sujet, je peins la vie.
La semaine dernière, un couple d’une soixantaine d’années est monté dans le métro. L’homme était défiguré par une énorme tumeur sur le côté droit, fermant son œil et déformant sa bouche jusqu’à son cou. Par ailleurs de haute taille, bien découplé, il ne manifestait aucune gêne des regards portés sur lui. Sa femme lui a pris la main, il a serré la sienne. Élégante, de la présence, elle s’imposait et son regard bleu azur s’est fixé sur le mien. Nous nous sommes regardées une seconde, comme si nous nous posions toutes les deux des questions auxquelles ni elle ni moi n’avions de réponse.
Quand ils sont tranquillement descendus à Concorde, je suis restée songeuse.
Expositions

Je vais rarement voir des expositions. Mes amis m’y pressent, mais j’attends la dernière minute et le plus souvent, je me réveille trop tard. Cette semaine, nous sommes allés voir celle d’Edvard Munch au musée d’Orsay, puis celles de Garouste et Alice Neel à Pompidou. C’était beaucoup, d’autant plus que nous avions vu les portraits de Kokoschka, il n’y a pas si longtemps.
Je repense à la réponse de mon ami David Azuz, alors que je lui proposais d’aller au Palais de Tokyo, pourtant pas loin de nos ateliers :
— Tu sais, je ne vais plus aux expositions. Soit elles me rasent, soit je suis jaloux !
Il m’avait fait rire. Aurai-je dû m’indigner ?
Comment ne pas être jaloux devant les peintures de Goya, de Manet, de tant d’autres ? Comment, pourquoi prendre ses pinceaux après de tels chefs d’œuvre ? Quelle force mystérieuse qui nous y pousse!
Mais voilà ! Difficile de ne pas passer à côté de Munch, l’auteur du Cri, le tableau le plus célèbre au monde après La Joconde. Garouste risquait de m’ennuyer, j’avais vu une de ses premières expositions (nous étions à l’École des Beaux-Arts de Paris en même temps) et je n’avais pas été très emballée, mais Pierre et Marie m’y avaient vivement encouragée. Seule Alice Neel m’attirait vraiment, elle avait peint avec simplicité ses amis à la maison, une démarche proche de la mienne.
Autrefois, j’entrais dans les musées avec une incroyable liberté. Ah, ces déambulations dans le Musée du Louvre à l’heure du déjeuner plutôt que d’aller à la cantine de l’école ! Ces découvertes, mes coups de cœur, ces liens qui se créaient peu à peu ! Les premières grandes salles, L’Enterrement à Ornans, la grande galerie et la peinture italienne, française (la dame qui pince le téton de sa voisine…), le petit escalier qui menait à La Jeune orpheline de Delacroix, aux Corot ! À peu près seule dans cette immensité, c’était mon jardin, mon palais secret, des fenêtres duquel je voyais couler la Seine et vivre Paris.
Aujourd’hui, une foule s’y presse. Des files d’attente sont canalisées en rubans labyrinthiques à l’entrée, et aussi à l’intérieur devant La Joconde enfermée dans une cage de verre anti balles.
Désormais, ces visites s’apparentent à un parcours du combattant. Il faut réserver à l’avance, choisir sa file, ruser avec l’affluence, attendre qu’un tableau se dégage. Plus question de bouger sans se cogner, il faut veiller à tout, se faufiler comme à la foire. Alors nous réservons à l’heure d’ouverture, nous filons aux dernières salles encore vides et revenons vers la foule agglutinée devant les explications. C’est ainsi que j’ai pu voir Le Pape Innocent X de Vélasquez, seuls, comme si je l’avais surpris à son réveil.
Munch. Aperçu entre les têtes des visiteurs, son expressionnisme n’est pas ma tasse de thé, comme on dit aujourd’hui. Mais peut-on comparer ce paisible breuvage évoquant la tante Léonie de Marcel Proust, aux tourments d’un homme qui durant toute sa vie a oscillé entre notoriété et hôpital psychiatrique. Le Cri n’était pas exposé, mais d’autres de la même période montraient le même effroi. Pierre Christin avait semblé perturbé par le succès dès l’origine de cette œuvre très difficile d’accès tant par la forme que par son contenu. On peut se poser la même question devant les portraits peu flatteurs de Kokoschka à Vienne. Un état d’esprit généralisé ayant quelque rapport avec les horreurs des deux guerres ?
Beaubourg, à trois avec mon frère Yves. Nous avons commencé par la rétrospective de Garouste.
Vingt zous ! Dès l’entrée, on en a pris plein la tête. Des toiles de sept mètres sur quatre, foisonnantes de personnages. La suite, une centaine de tableaux, évoquait les grands textes de l’humanité, La Divine comédie, la Bible, ainsi que ses souvenirs d’enfance, ses amis et des banquets mythiques dans un tourbillon de déformations, de couleurs et de noirs sonores ponctué par des visages clairs peints sur le vif parmi son entourage. Gigantesque et logorrhéique. Yves me dit :
— Bizarre, cela ne me parle pas.
Il finit par en reconnaître les incontestables qualités picturales et par apprécier. Enfin, après le déjeuner, nous nous sommes promenés parmi les portraits d’Alice Neel.
Toute autre chose ! Cette féministe new-yorkaise (1900-1984) a croqué sa société d’originaux avec une acuité éloignée de toute complaisance. Il en ressortait une acceptation des différences revigorante. Devant son regard sans jugement et affectueux, les modèles qui posaient chez elle dans son salon, sur son canapé, sur ses fauteuils ou ses chaises, parfois nus (Andy Warhol, femmes enceintes…) se laissaient aller à être eux-mêmes, sans fard. C’était un peu comme s’ils s’offraient à nous, avec la même générosité que celle du peintre. Ces portraits m’ont fait penser à la poésie d’Aragon :
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Et leurs baisers, au loin les suivent.
Travaux

Régulièrement, de l’eau coule et s’infiltre chez nous depuis l’appartement du dessus. Après six mois de séchage, le plafond tombe en lambeaux sur nos têtes et une entreprise de l’assurance vient réparer les dégâts.
Nous avons tous plus ou moins connu ce genre de désagréments.
Un beau matin à l’aube, on sonne à votre porte et une armée de peintres scotche des plastiques sur le palier, dans le couloir et s’installe pour une durée indéterminée. Allées et venues, échelles, outils et sacs de déchets, poussières d’enduits, pots de peinture seront votre quotidien.
Chaque matin, ces jeunes gens, lesquels aujourd’hui parlent rarement français, vont se changer le plus discrètement possible en arrivant, pas plus à l’aise que nous. Ils me verront sortant du lit, en robe de chambre, les cheveux dépeignés. Il faudra leur laisser la place dans la cuisine, jongler avec l’occupation des toilettes. Un mauvais moment à passer.
Des progrès apparaissent. L’équipe est désormais reliée à un réseau qui fait tourner les compagnons de chantier en chantier, qui distribue sur le trottoir les fournitures au fur et à mesure de l’avancement des travaux. On peut en permanence entrer en contact avec le chef. Efficacité et rapidité s’en suivent.
Il y a ceux qui cassent, ceux qui transportent les déchets, celui qui enduit et ponce, celui qui peint et tapisse. À chacun sa spécialité. Un peu comme à l’hôpital autour des tables d’opération.
On ne les distingue pas vraiment les uns des autres. On ne connait rien d’eux ni de leur vie et cela me gênait.
Carmen, la gardienne de l’immeuble m’avait raconté que son mari avait discuté avec un des ouvriers de la façade :
— Il avait mal à la tête. José lui a donné un Doliprane. L’ouvrier lui a dit qu’il n’arrivait pas à dormir parce qu’il pensait trop à sa famille restée en Algérie.
Elle-même avait connu cela, c’était dur !
Le dernier arrivé, un homme grand et basané, travaillait en silence, sombre et consciencieux. Sans savoir s’il parlait français, je me suis lancée :
— Vous venez de quel pays ?
Il n’a pas compris. J’ai pointé un doigt vers moi et j’ai dit :
— France !
Puis je l’ai dirigé vers lui :
— Vous ?
Il m’a regardée, stupéfait. Après une seconde d’hésitation, il a ouvert la bouche et j’ai deviné plus qu’entendu :
— Égyptian !
Avec des mimiques, je lui ai fait comprendre que j’étais allée en Égypte et j’ai ajouté :
— Magnifique !
Son visage s’est éclairé. Il avait compris. Toujours avec des mimiques et des mots simples, je lui ai demandé où il habitait. J’ai cru comprendre que c’était dans la banlieue du Caire et qu’il y avait laissé sa famille. J’ai compris qu’il avait deux enfants. Avec les paumes à distance du sol, je lui ai demandé leur âge :
— Deux et quatre ans, ai-je entendu.
J’ai demandé :
— Égypte, Mama ?
Il a dit oui. Et j’ai demandé leur prénom, toujours avec des mimiques :
— Mohamed, Ahmed, a-t-il dit en aspirant fort les H.
— Et la Mama ?
— Nadia !, accent tonique sur le premier A.
Pas facile à comprendre ! Mais le lien était établi. Je repensai à notre voyage en Égypte, lorsque nous avons remonté le Nil depuis Louxor. J’avais tellement aimé ce pays, ce fleuve, ces habitants bavards et rieurs. Je pensai à sa vie là-bas, au soleil égyptien, à sa vie en France. Je lui ai expliqué que j’avais aussi des enfants et aussi quatre petits-enfants. Il a paru intéressé. Il m’a demandé leur âge. Avec les mains et les doigts, j’ai égrené l’âge de mes enfants. Il voulait savoir l’âge de mes petits-enfants. Puis je lui ai montré son mobile :
— Téléphone, Égypte ? Tous les soirs ?
Son visage s’est illuminé et il a dit oui !
Il est encore resté une journée avant de terminer le chantier. Les déblayeurs sont venus ramasser les plastiques de protection et les outils. Il a posé le panneau de papier peint, peaufiné les détails et nous a dit que le chef allait venir dans vingt minutes pour clore le chantier. Il nous a dit au revoir et je lui ai dit :
— Ce soir, bonjour à Nadia, Mohamed et Ahmed !
Il a dit oui d’un air amusé et il est parti.
Quatre jours agités (suite)

Agnès m’avait téléphoné alors que nous roulions vers Grenoble. Conversation laborieuse, interrompue par le tunnel de Chambéry et difficilement reprise. Ayant profité des vacances de la Toussaint, elle arrivait tout juste de leur maison d’Intragna, un village accroché à la montagne au-dessus du lac Majeur en Italie.
Ils habitent dans le haut de Gex, dans la partie ancienne de la ville. J’ai déjà évoqué ces vieilles maisons aux murs épais dont les jardins s’étagent sous les remparts de l’ancien château fort. Longtemps le refuge des pauvres de la commune, occupées ensuite par des émigrés de l’après-guerre, elles sont aujourd’hui prisées et restaurées par des Nordiques et des Anglais travaillant dans les organisations internationales de Genève. De jardin en jardin, de terrasse en terrasse, ils forment une communauté cultivée et originale. Et l’année dernière, ils ont déposé les statuts d’une association culturelle programmant des événements variés ; expositions de photos, de céramiques, visionnage de courts métrages et ce jour-là un spectacle dans une grange.
Nous arrivions d’Albertville et la nuit tombait. Après un bref passage à Tougin, nous nous sommes aventurés dans les rues sombres et désertes de la vieille sous-préfecture. À l’écart, au pied des remparts, nous avons trouvé une grange, telle je ne pensais pas qu’il puisse encore en exister en centre-ville. Une voiture occupait le rez-de-chaussée. Personne nulle part. Nous allions continuer lorsque des chuchotements provenant de l’étage nous ont alertés. Nous avons grimpé un escalier de bois raide et blanchi par les siècles. Dans la pénombre vaguement éclairée par des guirlandes lumineuses, une assemblée écoutait en silence une mélopée accompagnée d’une sorte de harpe celtique. Les jeunes filles assises sur un plancher rustique jonché de feuilles mortes nous ont fait un passage et Wilfrid a surgi pour nous conduire vers un banc de bois.
Nos yeux s’habituant à l’obscurité, nous avons deviné les silhouettes d’une trentaine de personnes entourant une sorte de catafalque faiblement éclairé, composé de feuillages et de fleurs. Devant nous un grand gong en cuivre pendait à une potence de fer forgé.
Après une poésie déclamée par une jeune fille aux cheveux d’ondine, un son profond s’en éleva, monta, s’éteignit, reprit jusqu’à remplir l’espace, s’éleva à nouveau pour se replier lentement et se fondre définitivement dans le silence. La jeune fille nous convia alors à descendre pour déguster une soupe à la citrouille. On se leva. Wilfrid et Agnès nous présentèrent aux organisateurs. Tout autour, des jeunes, parfois très jeunes dont beaucoup parlaient anglais.
La pièce du haut se vida lentement. À la sortie, une jeune fille nous incita à couper une tige de lierre à laquelle était accroché un petit rouleau de papier. Une poésie y était calligraphiée. Nous devions la lire à haute voix avant d’accéder au rez-de-chaussée débarrassé de la voiture ayant servi à camoufler le buffet orné de feuillage.
Il se trouve que depuis mon enfance je ne supporte pas la soupe au potiron. On pouvait me priver de dessert et même de repas, sans que j’accepte d’en avaler la moindre cuillérée. Heureusement, Agnès et Wilfrid avaient concocté une soupe avec des châtaignes rapportées d’Italie. Avec une lichée de crème bio de la même origine, ce fut un délice. Elle cuisait sur un feu de bois maintenu dans une vasque métallique, au fond d’un chaudron suspendu à des fourches.
Nos amis nous ont présenté plusieurs des membres de l’association, ce qui nous a rajeunis. Des décennies auparavant, débarquant dans une région à l’époque encore presque exclusivement agricole, à l’initiative de Mazé Guillot, nous avions créé Le Mouvement artistique du Pays de Gex. Nous en avons gardé de chers amis tout au long de notre vie. Plusieurs ont fait de beaux parcours : Julian exposant ses bijoux sur la Cinquième avenue, Joël, invité principal du Printemps des poètes de Paris, Henriette à Genève, Karen en Californie.
Enfin, Wilfrid, à la lumière de son portable, nous a conduits chez lui par les cours et les jardins. Nous avons pu embrasser Armand qui s’apprêtait à partir, les vacances terminées. Il est en deuxième année d’EPFL, une école d’ingénieur terriblement difficile. Agnès le déposait à Coppet au train de Lausanne.
Après une nuit réparatrice et encore quelques rangements, avant de fermer la maison et de prendre le car, puis le TGV pour Paris, Gilles a commenté la soirée :
— Si le feu avait pris dans la grange, on serait probablement tous morts !
Halloween !