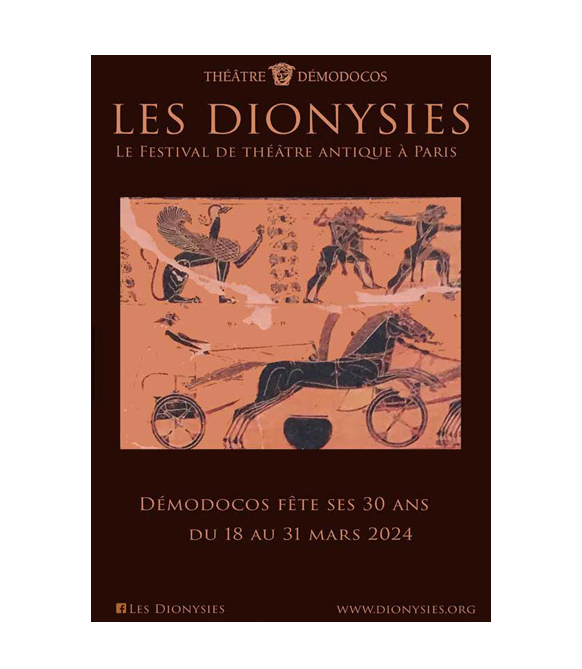
La semaine dernière, je n’ai pas eu le temps de vous parler de Luce…
À 22 ans, après un diplôme sur Huysmans, Luce finit une maîtrise de lettres modernes. Je l’ai connue à Philomuses. Nous démarrions toutes les deux le théâtre. Elle s’essayait à Célimène et je me lançais, comme je pouvais, dans le monologue de Claudel : « Qu’est que le théâtre ? »
Par la suite, le Covid arrêta nos balbutiements. Jeune étudiante, elle fut confinée dans une chambre de bonne durant trois mois, une épreuve pour cet oiseau de liberté. Dès qu’elle le put, elle partit, sac sur le dos et caméra mobile à la main, interviewer les compagnies de théâtre de province sur l’impact de l’épidémie sur leurs créations. Au retour, elle s’essaya dans un cours prestigieux, mais n’y trouvant pas son compte, elle reprit ses études de lettres. Son enthousiasme m’enchante !
Nous nous voyons au gré des circonstances. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvées au café des Petits Carreaux dans la rue du même nom. Luce est curieuse de tout. La rencontrer me revigore ! Elle m’offrit avec délicatesse Les Yeux de Mona, le parcours d’un grand-père et de sa petite fille dans les musées de Paris. Quand j’avais son âge, plutôt que d’aller à la cantine de mon école des Métiers d’art, j’avais déambulé jour après jour dans le Louvre, comme dans un jardin sans limites. Son geste fit remonter de puissants souvenirs. J’aime ces concordances…
À l’occasion de l’ouverture du festival des Dionysies, ce fut un autre plaisir d’aller à la Sorbonne écouter Aymeric Münch évoquer sa traduction du Chant de la terre de Virgile. J’ai connu Aymeric à Argenton-sur-Creuse, il y a plus de 10 ans. Il jouait le Messager dans Les Perses d’Eschyle. Il virevoltait, chemise au vent, dans l’immense amphithéâtre romain, annonçant avec force et frénésie les désastres de la guerre perdue par Darius. J’avais aimé l’énergie du jeune helléniste qui s’apprêtait à démarrer une carrière de professeur. Avec Philippe Brunet et sa compagnie Démodocos, il m’ouvrait les portes d’une Grèce antique à laquelle je n’avais pas eu accès durant mes études. Il me rendait familière d’un univers que je pensais réservé aux seuls initiés.
Par la suite, je me souviens de sa traduction des Géorgiques. Il l’avait lu dans le superbe réfectoire des Cordeliers, accompagné au violoncelle par son neveu. Issus d’une famille de musiciens bien connue, ils vibraient à l’unisson. Le bourdonnement des abeilles, le grondement de l’orage et des sabots sur le sol surgissaient de la scansion des vers et de l’archet du violoncelle. Durant mes études, malgré la qualité de notre professeur, qu’on surnommait, avec respect et affection, le Grand Jacques, j’avais tout juste soupçonné à travers nos laborieuses traductions la force de la poésie virgilienne. Elle m’était offerte des décennies plus tard, quand je ne l’espérais plus.
C’est ainsi que j’ai retrouvé Gilles dans l’étonnante salle des Actes de la Sorbonne et que nous avons entendu Aymeric nous raconter la genèse de ses traductions. Passionnant ! Commentant des lectures choisies, il nous faisait part de ses hésitations, de ses choix, de sa volonté de rester dans le rythme de l’hexamètre français. Un bouillonnement qui offrait une vie contemporaine à des textes mille fois traduits et retraduits. Aymeric en profitait pour associer le contenu encyclopédique de Virgile aux préoccupations actuelles, aux méthodes numériques avec une rafraîchissante énergie.
À coté de son épouse, mère attentive, sa petite fille de quatre-cinq ans était restée sagement silencieuse durant la conférence. À la sortie, elle s’est jetée dans les bras de son père et tous deux ont entamé quelques pas de danse. Que lui restera-t-il de cette auguste soirée ?
Quelques jours et toujours dans le cadre du festival des Dionysies, j’ai retrouvé Gilles, mon frère Yves et Luce à Jussieu pour une évocation du désastre dans l’antiquité à travers les textes qui nous sont parvenus.
Chez Hésiode (VIIe siècle av. J.-C), la lente dégradation des humains vers un individualisme destructeur, vers la recherche du pouvoir et la guerre en conséquence. Nous avons pensé aux dictateurs actuels de plus en plus nombreux, élus dans des démocraties qui n’en ont que le nom.
Chez Thucydide (Ve siècle av. J. C), la peste et ses effroyables descriptions. Chez Lucrèce (Ie siècle av. J. C), la même peste, traduite du latin en hexamètre par Guillaume, texte philosophique et poétique extraite du De natura rerum. Naturellement, nous avons pensé au Covid, tout de même moins ravageur, mais peut-être le prélude à bien pire.
Enfin Lucain (Ie siècle ap. J. C), la guerre civile et ses conséquences dévastatrices : destruction et barbarie. Et nous avons pensé au monde actuel, à la guerre en Ukraine, au pilonnage de la bande de Gaza, au danger atomique, à la fragilité de notre monde numérique.
Oui, la barbarie n’est jamais loin. Après la chute de Rome, il fallut de nombreux siècles d’obscurantisme avant la Renaissance et le retour d’un humanisme avec Érasme et Montaigne. Humanisme aujourd’hui remis en cause.
Et je pense au sourire inquiet de Luce, quand elle m’a demandé :
— Martine, vous aviez de bons moments pendant la guerre ?
