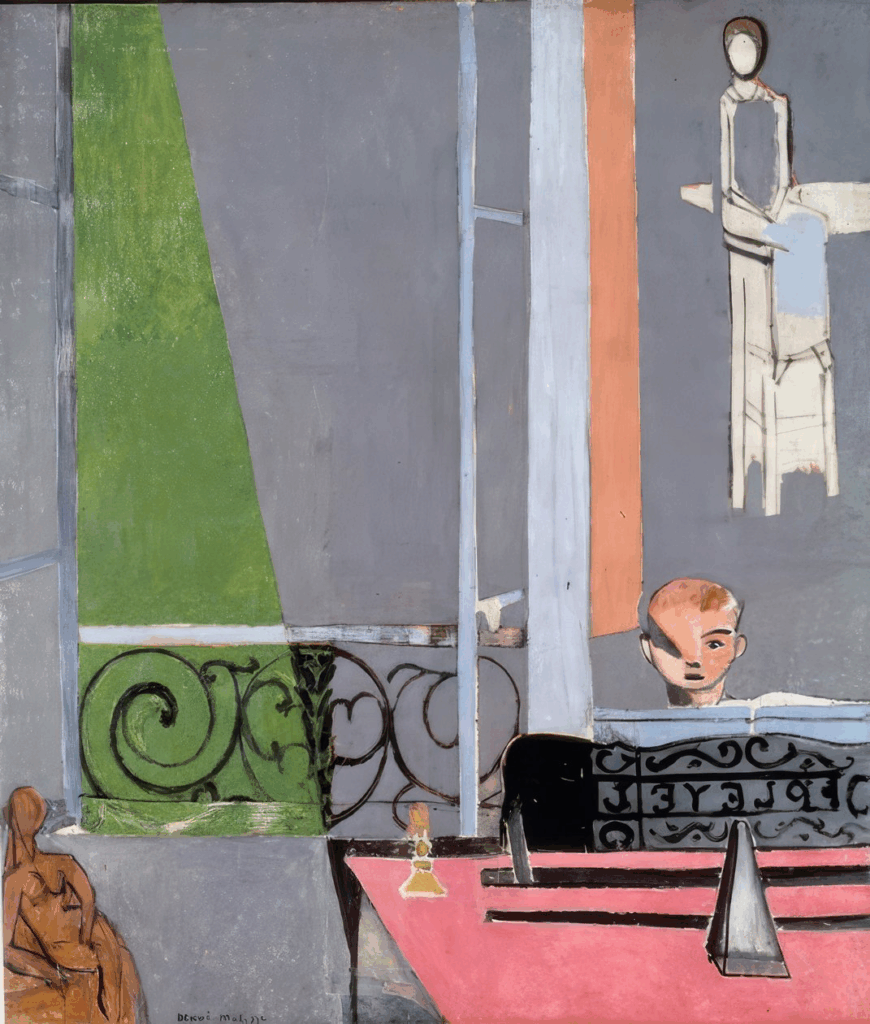Combien de temps vais-je continuer ces chroniques ? J’ai parfois envie d’arrêter, mais quelque chose me retient. Votre présence, invisible mais réelle ? Quand je suis devant mon clavier, je suis avec vous, un sentiment fort, mystérieux et touchant, assez proche de ces amitiés de longue date qui demeurent malgré la distance et l’absence.
Me relisant, je m’étonne des choix qui guident ces récits. Pourquoi telle anecdote plutôt qu’une autre ? Pourquoi certains silences sur des sujets qui me tiennent à cœur ? Pourquoi de longues pages sur des situations éphémères ? Pourquoi évoquer les événements nationaux et internationaux, quand nous en sommes tous abreuvés par les médias et que je me sens démunie face à eux ?
En fait, j’écris comme on plonge dans l’inconnu, sans savoir ce qui sortira de mon clavier et je crois que c’est cette liberté que j’aime partager avec vous.
Samedi, nous sommes allés à une cérémonie en hommage à Anahita Bathaie, une costumière de la compagnie Démodocos. Je ne la connaissais pas, mais j’avais admiré ses costumes des Perses. Dans une performance, elle avait fait parler des masques fabriqués dans son village d’origine en Iran. À l’âge de 40 ans, elle vient de mourir d’un cancer foudroyant, laissant un enfant de six ans.
Gilles était invité à cet hommage dans la gallery Fernand Leger, lieu culturel de la ville d‘Ivry dont elle était un des piliers. Or cette ville avait rempli mon imaginaire à ma sortie des écoles d’art. Mon ami Patrick Poirier et son épouse Anne avaient été hébergés dans un de ses ateliers à leur retour de la Villa Médicis, démarrage d’une brillante carrière internationale. Je voulais en savoir plus sur ce lieu resté exceptionnellement communiste.
En sortant du métro, nous avons plongé dans un monde de béton antédiluvien, des terrasses dressaient leurs pointes en V à la Vauban. Pas très convivial et même sinistre ! Un témoignage des années 70, au cœur des fameuses « Trente glorieuses » où les investissements ne mégotaient pas sur la dépense, surtout dans les mairies communistes du pourtour de Paris. Les architectes nageaient en pleine utopie, plus sociologues que réalistes, ils imaginaient refaire le monde.
Difficile de trouver son chemin dans cet univers morcelé, nous nous sommes approchés d’une porte vitrée éclairée derrière des gros piliers en V. Un homme en est sorti qui nous a désigné un escalier menant au deuxième sous-sol. En bas, une foule silencieuse avait débordé d’un auditorium, elle s’était glissée de chaque côté d’une table qui s’étendait tout le long d’une vaste salle en V pouvant accueillir à l’aise une centaine de convives. Le couvert était mis.
Sur un mur, un grand écran transmettait une vidéo, montrant Anahita dans tous les épisodes de sa vie, de l’enfance à ses combats pour la liberté, son exil, et ses activités artistiques. Elle montrait une personnalité forte, d’innombrables amitiés, des fêtes, des bons repas, des week-ends à la campagne. Une vie intense tissée de générosité et d’inventivité.
Ce genre de commémoration me laisse toujours un peu gênée. Un peu comme si je restais à la porte d’un paradis inaccessible.
Nous nous sommes assis sur les chaises prévues pour le repas. Autour de nous s’agitait la communauté iranienne. Dans l’auditorium, on devinait un monde d’artistes, mais dans la salle la diaspora s’installait comme une vaste famille. La tristesse accompagnait le bonheur de se retrouver. Tout le monde se connaissait et s’embrassait.
Je ne pouvais m’empêcher de penser qu’au même moment, la répression s’abattait sur l’Iran.
(à suivre.)