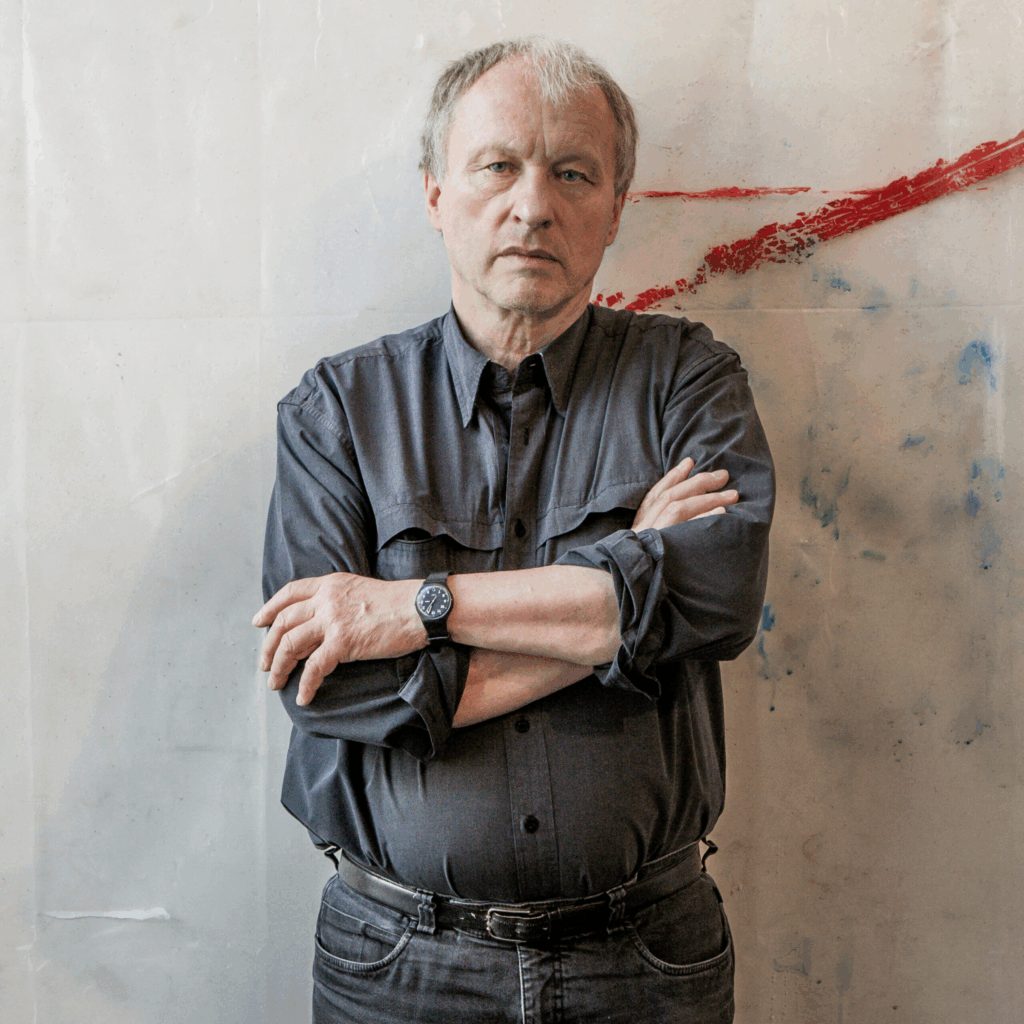Nous ne sommes pas allés à Nantes, des inondations rendaient le trajet problématique.
Le 28 février, Donald Trump, sans l’aval du Congrès, a donné l’ordre de bombarder le centre du pouvoir à Téhéran, tuant Ali Khamenei, ainsi que les hauts dignitaires du régime réunis dans une même salle. Guide suprême de l’Iran depuis 36 ans, il avait succédé à l’ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d’Iran. Tous deux religieux fanatiques et sanguinaires.
L’Iran a aussitôt répliqué par des frappes contre l’État hébreu, mais aussi contre d’autres pays de la région comme les Émirats arabes unis, le Qatar ou le Bahreïn.
Hier, des frappes américaines et israéliennes se sont succédé sur l’Iran et le Liban. L’Iran a riposté jusque sur une base britannique à Chypre. L’Iran a bloqué le détroit d’Ormuz, interrompant le trafic pétrolier.
Donald Trump a ouvert la boîte de Pandore. Le Moyen-Orient est en feu. Une boîte qui peut mettre des années à se refermer.
Lui qui ne lit jamais, qui n’écoute que ses impulsions, comment aurait-il pu tirer des leçons des défaites américaines au Vietnam, en Irak, en Afghanistan ? Comment aurait-il su qu’un pays dont l’opposition a été systématiquement emprisonnée, torturée et tuée, ne possède pas de dirigeants de remplacement, qu’il est par nature livré à l’anarchie et aux appétits carnassiers, comme en Libye ou en Irak ? Voulait-il seulement détourner l’attention de l’affaire Epstein ? Est-il sous l’influence de Nettanyahou, chef jusqu’au-boutiste du gouvernement israélien ?
Des pourparlers étaient engagés à Genève. Utopies ? Il est vrai qu’on ne voit pas comment les « gardiens de la révolution », qui terrorisent le peuple iranien au quotidien et accumulent des fortunes considérables peuvent être neutralisés. Mais la guerre n’y changera rien, au contraire.
Triste semaine ! Roger a succombé au cancer qui, il y a plus de dix ans, aurait dû l’emporter en quelques mois. Il s’est éteint chez lui à San Francisco, entouré de tous les siens. Je n’insisterai pas sur notre tristesse. Un homme droit et bon, curieux et indulgent, rieur. En scientifique, il avait passionnément observé les traitements d’avant-garde qui lui ont permis de survivre des années et même de suivre presque jusqu’au bout le travail de ses étudiants. Comme il va nous manquer, manquer à Sally !
À son dernier passage à Paris, j’évoquais notre première rencontre.
— Sally, tu étais tellement jolie ! Ton sourire, tes longs cheveux… Tu ressemblais un peu à Ali Mac Graw, en plus jolie !
Et Roger a rectifié, avec son sourire si particulier :
— Sally est toujours belle !
Je préfère vous raconter quelques moments vécus avec eux dans notre jeunesse.
C’était en 1970. Nous nous sommes connus quand, physicien, il faisait un post doc à Paris dans le labo de Gilles, à l’École polytechnique.
Après la naissance d’Ève et Michaël, nous avons déménagé dans le Pays de Gex près du CERN.
C’était le temps de la guerre du Vietnam et des révoltes raciales aux États-Unis. Ils voulaient se désolidariser de leur pays, se ressourcer en France et en Europe.
Chez nous c’était l’après-soixante-huit, la société s’était assouplie, nous avions l’avenir devant nous. Sally et moi élevions nos enfants avec l’impression de changer le monde. Ils vivaient dans une ancienne ferme qui servait de réserve à un antiquaire de Genève, au milieu de meubles et d’objets anciens, patinés par le temps. Nous aimions leur vitalité, l’enthousiasme de Roger, l’originalité de Sally, étrangère à nos conventions. C’était l’époque hippie.
Le Pays de Gex ne s’était pas encore développé et nous vivions dans un monde rural. Roger s’était passionné pour les champignons, et pour les fromages français. Il en affinait dans le placard de leur chambre à coucher.
Leurs parents sont venus les visiter, nous leur avons fait connaître nos familles. Nous prenions plaisir à nos différences. Peu à peu, nous sommes devenus un peu comme des frères et sœurs. Et ces liens d’une totale liberté, d’années en années se sont affirmés. Nous sommes allés plusieurs fois les voir à leur retour à San Francisco. Eux venaient chaque année en Europe. Ils faisaient des randonnées à pied (en particulier le chemin de Stevenson) avec leur ami Jeff et finissaient leur séjour à Saint Julien au bord de la Garonne avec leurs enfants et des amis venus des USA.
(à suivre)